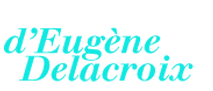Index nominum
Biographie de GERARD François-Pascal-Simon, baron (1770-1837)
François Gérard naît à Rome d’un père français, intendant du cardinal de Bernis, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, et d’une mère italienne. En 1782, il rentre avec sa famille à Paris où il devient l’élève du sculpteur Augustin Pajou (1730-1809) puis du peintre Nicolas-Guy Brenet (1728-1792), avant d’entrer dans l’atelier de David en 1786. S’il obtient rapidement les faveurs de son maître, il échoue au prix de Rome de 1789, obtenant la deuxième place derrière Girodet. Après la mort de son père et un retour en Italie, il est de nouveau à Paris en 1791 où il collabore avec David. Grâce à l’appui de celui-ci, il évite la conscription au prix d’une nomination au Tribunal révolutionnaire, auprès duquel il ne siège toutefois pratiquement pas, simulant une infirmité. Laissé sans ressources après la mort de sa mère en 1793, il gagne sa vie en illustrant des éditions de luxe d’ouvrages classiques (La Fontaine, Virgile et Racine) pour l’imprimeur Pierre Didot.
Il établit sa réputation et obtient ses premiers succès grâce à l’appui de son ami le peintre et miniaturiste Jean-Baptiste Isabey (1767-1855). Celui-ci lui commande un Bélisaire (collection privée, Munich), réalisé en dix-huit jours et acclamé au Salon de 1795, après quoi Gérard réalise la même année un portrait d’Isabey et de sa fille de quatre ans (musée du Louvre, Paris) qui attire de nouveau l’attention sur lui au Salon de 1796.
À partir de cette réussite incontestable, la réputation et le succès de Gérard s’appuieront avant tout sur son activité de portraitiste. Grâce à ses premières réalisations, il obtient les commandes de Bonaparte, de sa famille et de son entourage, culminant avec des réalisations comme Joséphine à la Malmaison (1801, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg), Madame Récamier (1805, musée Carnavalet, Paris) et le portrait de Napoléon Ier en costume du Sacre (1805, différentes versions). Avec ces réalisations, François Gérard devient le peintre portraitiste le plus couru en France sous l’Empire et la Restauration, et produit entre 1800 et 1815 environ cinquante portraits en pied et quarante en buste.
À côté de son activité de portraitiste, Gérard s’essaie à la peinture d’histoire. Le Bélisaire est suivi en 1797 par Psyché recevant le premier baiser de l’Amour (Paris, Louvre) qui fait sensation au Salon de 1798. S’ensuivent des peintures d’inspiration littéraire avec l’Ossian évoque les fantômes au son de la harpe sur les bords du Lora (1801, Kunsthalle, Hambourg) et Corinne au cap Misène (1819, musée des Beaux-Arts de Lyon) composé en hommage à Mme de Staël. A partir des années 1810, et alors que se diffuse le goût pour le passé historique de la France, il retourne vers des sujets de caractère historique avec des réalisations telles que La bataille d’Austerlitz (1810, Château de Versailles), L’entrée de Henri IV à Paris (1817, Château de Versailles) ou encore le Couronnement de Charles X (1827, Versailles). Son activité de peintre d’histoire, longtemps peu considérée, a fait depuis l’objet d’une certaine réévaluation.
Son succès sous l’Empire et la Restauration, couplé avec sa modération politique, lui font obtenir les plus grands honneurs. Il est chevalier de la Légion d’honneur dès la création de l’ordre en 1802, premier peintre de l’impératrice Joséphine en 1806, professeur à l’École des Beaux-Arts en 1811 et membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1812, dont il en devient le président en 1820. En 1819 il est promu baron héréditaire. Cette carrière politique lui attira l’image d’un peintre courtisan, parfaitement exprimée par Baudelaire en 1868 :
« Le baron Gérard fut dans les arts ce qu’il était dans son salon, l’amphitryon qui veut plaire à tout le monde, et c’est cet éclectisme courtisanesque qui l’a perdu. David, Guérin et Girodet sont restés, débris inébranlables et invulnérables de cette grande école, et Gérard n’a laissé que la réputation d’un homme aimable et très spirituel. Du reste, c’est lui qui a annoncé la venue d’Eugène Delacroix et qui a dit : Un peintre nous est né ! C’est un homme qui court sur les toits. » (Baudelaire, œuvre complètes, t. II, Paris, Gallimard, 1976, p. 411)
Le baron Gérard semble avoir joué un rôle non négligeable dans le début de la carrière d’Eugène Delacroix. Ce dernier est introduit à Gérard en 1822, alors que Delacroix s’apprête à se faire connaître avec La Barque de Dante (Lettre du 16-17 juin 1822, Journal du 5 octobre 1822). A propos de ce tableau et à l’occasion du Salon de 1822, Gérard aurait inspiré l’article flatteur écrit par Adolphe Thiers dans Le Constitutionnel du 11 mai 1822 : « M. Thiers rédigeait, dans ce temps-là, dans le Constitutionnel, des articles sur les expositions de peintures, et il fit, sur l’obscur débutant, un article par-dessus les toits. Il y avait été encouragé par Gérard, qui, lui aussi, voyait dans mon premier tableau beaucoup d’avenir. » (Journal, éd. Hannoosh, t. II, p. 1741). L’article est resté célèbre grâce à la longue citation que Baudelaire en fait dans son Salon de 1846. Dans cet article, Thiers attribue à Delacroix « l’imagination poétique » et « l’imagination du dessin », « la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens ».
De même en 1824, Gérard, que Delacroix rencontre au musée du Louvre, lui adresse les « éloges les plus flatteurs » pour les Scènes des Massacres de Scio (Musée du Louvre, Paris), et l’invite à dîner dans sa demeure de campagne à Auteuil (Journal, 19 août 1824). Là, il rencontre Thiers, et c’est peut-être à nouveau une parole bienveillante de Gérard qui influence les articles élogieux de Thiers sur les Massacres, publiés dans Le Constitutionnel des 25 et 30 août et surtout dans Le Globe du 28 septembre. Il aurait également facilité l’achat du tableau par l’État pour une somme de 6 000 francs.
À partir de 1822, Delacroix fréquente régulièrement le Salon du baron Gérard. Celui-ci reçoit chez lui rue Saint-Germain-des-Prés (actuellement 34, rue Bonaparte), les mercredis soirs, de nombreuses personnalités publiques : des hommes politiques (Talleyrand, Pozzo di Borgo, Thiers), des littérateurs (Stendhal, Balzac, Sophie Gay, Prosper Mérimée), des peintres (Ingres, Delacroix), des scientifique (Cuvier), des musiciens, (Rossini, Maria Malibran), des actrices (Mademoiselle Mars), etc. On y joue au whist, à minuit on sert du thé et des gâteaux, après quoi on écoute du chant. L’été, le baron Gérard reçoit le lundi à Auteuil. Ces réceptions se poursuivent jusqu’à la mort du peintre en 1837, et constituent un rendez-vous important pour Delacroix qui en donne une description dans son Cahier Autobiographique :
« Le salon de Gérard était un des choses les plus curieuses de ce temps. L’homme lui-même était un type rare. On arrivait chez lui à l’italienne, c’est-à-dire à minuit, et souvent le maître de la maison s’animait et était charmant par ses souvenirs. J’ai entendu dire tant de sottises sur les hommes connus, que je me défie beaucoup des réputations que l’on fait aux gens. Gérard passait pour courtisan : on en faisait une espère de diplomate extrêmement raffiné. Il faut dire que toutes les fois que je lui ai demandé quelque petit service, je l’ai trouvé très entortillé dans ses réponses. » (Journal, éd. Hannoosh, t. II, p. 1744-1745)
Delacroix rencontre Stendhal dans son salon à la fin de l’année 1824 et se lie véritablement avec lui en 1826. Ensemble avec Prosper Mérimée, Sutton Sharpe, Horace de Viel-Castel, David-Ferdinand Koreff, et d’autres encore, ils y forment une sorte de groupe informel finissant régulièrement leurs soirées « chez la Lériche », ou dans d’autres maisons de tolérance (Journal, éd. Hannoosh, t. II, p. 1745)
Sur l’œuvre de Gérard, si Delacroix était extrêmement critique envers les compositions des pendentifs du Panthéon (Journal, 19 janvier 1847), il appréciait tout particulièrement le Bélisaire (« tout semble conçu […] de manière à faire ressortir le côté poétique du sujet », Journal, éd. Hannoosh, t. II, p. 1799-1800), et reconnaissait avant tout la qualité d’ordonnance de la peinture de Gérard (Journal, éd. Hannoosh, t. I, p. 1107). En 1837, Delacroix fut candidat à la reprise du fauteuil d’académicien laissé libre par la mort du baron Gérard.
Les correspondances associées
Aucun résultat ne correspond à votre recherche