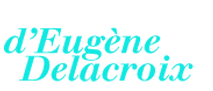A propos des correspondances
Préface des Lettres de Eugène Delacroix par Philippe Burty (seconde édition, 1880)
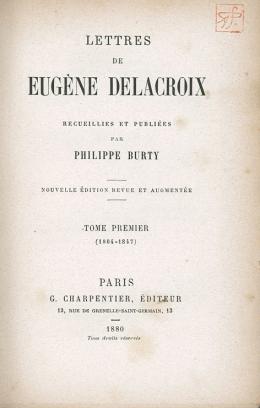
"Au moment où, ramené de sa chère maison de Champrosay dans un état d’épuisement extrême, Eugène Delacroix eut le sentiment de sa fin prochaine, il anéantit un testament antérieur, fit appeler les notaires et, sans s’interrompre, pendant trois heures, avec une lucidité de mémoire et de parole surprenante, il dicta ses nouvelles et définitives dispositions.
Ce testament offre en résumé l’histoire de son génie et de son cœur.
L’art et l’amitié avaient été les mobiles et les soutiens contants de la vie de Delacroix, l’art et l’amitié interviennent seuls dans ses préoccupations suprêmes. Avant tout, il pense à assurer le repos de ceux qui l’ont touché de près : de son parent et ami le peintre Léon Riesener, de son élève Pierre Andrieu, qui l’a secondé avec une si rare abnégation ; de sa gouvernante Jenny Le Guillou, dont les soins passionnés et jaloux ont prolongé son souffle frêle, toujours menacé. Il envoie à chaque ami un souvenir. Puis il impose à son légataire universel l’obligation d’une vente publique de ses études, de ses cartons, de ses esquisses, de ses toiles, sorte de confession publique qui le vengera des dédains, des déboires, des négations recueillis presque sans interruption dans le cours de sa carrière d’artiste. Enfin il veut reposer sous un noble tombeau, tout opposé, par le style, à ce qui a fait la fortune de ses imbéciles persécuteurs.
Voici ce précieux document ; nous n’en avons réservé que quelques paragraphes ayant trait à des arrangements de famille, sans intérêt général.
Par-devant maîtres …, notaires à Paris, soussignés, en présence de MM …, témoins instrumentaires requis, etc.,
A comparu :
M. Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix, peintre, membre de l’Institut, demeurant à Paris, rue Furstemberg, n° 6,
Sain d’esprit, mémoire et entendement, ainsi qu’il est apparu auxdits notaires et témoins par ses discours et conversation, mais malade de corps ; trouvé par lesdits notaires et témoins couché dans un lit dans sa chambre à coucher, éclairée par une croisée sur un jardin, dépendant de l’appartement qu’il occupe au premier étage de ladite maison, entre cour et jardin, où lesdits notaires et témoins s’étaient rendus sur l’invitation qui leur a été faite par M. Delacroix ;
Lequel, dans la vue de la mort, a dicté son testament aux-dits notaires en présence desdits témoins, ainsi qu’il suit :
CECI EST MON TESTAMENT :
Je révoque tout testament et toutes dispositions antérieurs au présent testament.
J’institue pour légataire universel M. PIRON, ancien administrateur des Postes ; je le prie de vouloir se charger de l’exécution de mes dernières volontés.
Je vais disposer au profit de Divers de la presque totalité de ma fortune ; il restera fort peu de chose pour mon légataire universel, car cela dépendra du prix que produira la vente de mes objets d’art ; mais je compte sur son amitié, et je sais qu’il n’hésitera pas à remplir mes dernières volontés. D’ailleurs, je ne lui aurais pas imposé une charge semblable si je n’avais la certitude que le produit de la vente sera supérieur au legs que je fais ci-après.
Dans le cas où M. PIRON ne voudrait ou ne pourrait accepter ce legs universel, j’institue pour légataire universel, à son défaut, M. le baron RIVET, administrateur du chemin de l’Ouest.
Je charge mon légataire universel du paiement des legs ci-après :
Je lègue à M. LÉON RIESENER, mon cousin, une somme de vingt mille francs (20,000 fr.) et la toute propriété de ma maison de campagne de Champrosay, avec toutes ses dépendances et tous les meubles meublants le garnissant. Tous les tableaux, objets d’art et livres s’y trouvant ne sont pas compris dans ce legs. Je lui lègue en outre le portrait de mon cousin Henri Hugues, le portrait de son père à la mine de plomb, plus la pendule et les flambeaux en bronze garnissant la cheminée de ma chambre à coucher de Paris, plus une grisaille que j’ai peinte d’après lui, plus le petit portrait de mon frère couché. Je le prie de reprendre les peintures chez lui qui se trouvent chez moi.
Je lègue à M. ANDRIEU, peintre, une somme de quinze mille francs (15,000 fr.), plus une esquisse de la Chapelle de Saint-Sulpice, plus un Lion couché peint par moi sur papier reporté sur toile, et une copie par lui des Femmes d’Alger, plus les croquis que j’ai faits pour le Salon de la Paix.
Je le prie de reprendre des esquisses qu’il a faites d’après l’ensemble des travaux du Salon de la Paix, à l’Hôtel de Ville.
Je lègue à Jeanne-Marie Le Guillou une somme de cinquante mille francs (50,000 fr.), plus ce qui sera à sa convenance dans son mobilier…, en un mot ce qu’il lui plaira de choisir pour se composer le mobilier d’un petit appartement convenable ;
Plus plusieurs croquis ou peintures que j’ai désignés pour lui appartenir en l’écrivant au dos de ces objets ;
Plus l’un de mes deux portraits en buste, peints par moi (celui ayant un gilet vert écossais), plus deux médaillons en terre cuite, cadre dorés, de mon père et de ma mère, ainsi que les miniatures de mon père et de mes deux frères.
Je lègue à M. le commandant DELACROIX, mon cousin, une bague en or, donnée à mon frère par le prince Eugène, avec ces mots : Fidélité, Valeur ; plus un petit revolver, un sabre donné à mon frère par le prince Eugène (le nom du prince Eugène est gravé sur la lame), un tromblon anglais venant de mon frère, plus la grande médaille d’or que j’ai reçue à l’Exposition de 1855.
Je lègue à M. BERRYER, mon parent, le Portrait du pape par Lawrence (gravure), plus une belle aquarelle de Fauvel (Vue d’Athènes).
A. M. Auguste BORNOT, mon cousin, le portrait de ma grand’mère, les deux portraits de mes deux frères enfants, les peintures et les dessins que j’ai eux de la succession de mon cousin Bataille.
A M. le baron RIVET, sus-nommé, copie du portrait de Charles II, roi d’Espagne, d’après Velasquez ; fleurs sur carton mince avec un cadre étroit (peinture) ; tableau inachevé de Bonington (Chevalier et Page) et une petite toile portant deux sujets en grisaille du même.
A M. le baron SCHWITER, mon petit tableau de Watteau (les Apothicaires), tableau de Chardin (Raisins, poires, etc.), un grand paysage inachevé de Th. Fielding.
A M. Louis GUILLEMARDET, un petit Enfant en marbre, un vase de porcelaine forme bouteille, bleu céladon ; quarante jetons environ en argent, offerts autrefois à mon père par la ville de Bordeaux ; quatre flambeaux dorés style Louis XV, une petite médaille d’or de Lucius Verus, qui m’a été léguée par notre cher Félix.
A M. Ferdinand LEROY, directeur de la caisse des Travaux de Paris, un beau pastel à son choix parmi mes Etudes de paysage.
A M. SAGNIER, rue du Mail, n° 13, un pastel semblable, à son choix.
A M. THIERS, un bronze de Germain Pilon et un petit Lion antique, également en bronze.
A M. CHARIER, conseiller maître des Comptes, la Revue du Premier Consul (gravure), plus les Œuvres de Regnard venant de M. Vieillard, plus un serre-papier de bronze représentant une petite diane.
A Mme la baronne DE FORGET, un petit coffre en porcelaine de Sèvres doublé de métal, une petite bague antique en or, avec pierre fouillée par l’outil ; une petite miniature de l’impératrice Joséphine. Elle voudra bien faire reprendre le volume qu’elle m’a prêté des Antiquités d’Herculanum.
A Mme la baronne de RUBEMPRÉ, une copie de Sainte en buste, tenant une palme et une épée, d’après Alonzo Cano.
A Mme SAND, un petit couteau turc, un serpent en plomb qui lui avait été donné par Mme Dorval, une grande esquisse représentant le Sabbat de Faust (effet de nuit).
A M. HARO, la collection de médailles qui m’a été donnée à l’Exposition universelle comme membre de la Commission impériale. J’ai le regret d’avoir distrait celle de bronze.
A M. François DE VERNINAC, président du tribunal à Tulle, un grand bureau à cuivres dorés qui me vient de mon beau-frère.
A Mme DURIEZ DE VERNINAC, le portrait de ma sœur par David, le buste en marbre de Mme de Verninac, trois portraits de mon neveu, l’un se trouvant à la tête de mon lit, et le second en ébauche dans mon atelier ; le troisième est un petit buste de face, la tête grandeur de nature ; deux portraits de mon père et de mon frère, les masques en bronze de mon père et de mon neveu Charles, un dessin allégorique d’Androclès, fait à Lyon en l’honneur de mon beau-frère, et des Vues de Constantinople encadrées de noir, ainsi qu’un tableau représentant la série des Empereurs turcs.
Je le prie de vouloir bien répartir entre M. son frère et son excellente sœur, Mme PERRUGUES, ces souvenirs de famille.
A M. COURNAULT, à Malzéville, près Nancy, mes deux coffres de Maroc et tous les objets venant d’Alger, armes, vêtements, coussins, écharpes, etc.
A Mme CAVÉ, deux vases en faïence avec des cordes pour ornements.
Je lègue à M. MARÉCHAL, de Metz, plusieurs pastels d’études pour Sardanapale, plus la belle copie de Géricault d’après les Géants de Paul Véronèse.
Je lègue à M. DEVILLY, à Metz, une répétition ébauchée du Christ portant sa croix, plus un dessin à son choix dans mes Études de Maroc.
Mon tombeau sera au cimetière du Père-La-Chaise, sur la hauteur, dans un endroit un peu écarté. Il n’y sera placé ni emblème, ni buste, ni statue ; mon tombeau sera copié très exactement sur l’antique, ou Vignoles ou Palladio, avec des saillies très prononcées, contrairement à tout ce qui se fait aujourd’hui en architecture.
Après ma mort, il ne sera fait aucune reproduction de mes traits, soit par le moulage, soit par dessin ou photographie ; je le défends expressément.
J’entends formellement qu’il y ait vente publique et aux enchères, par commissaire-priseur, de tout ce qui m’aura appartenu en dehors des objets que j’ai légués,
Et j’impose à mon légataire universel l’obligation rigoureuse de faire procéder à cette vente dans les deux ans qui suivront mon décès.
Je désire sans en faire une loi, que la vente des objets d’art soit dirigée par MM. PETIT et TEDESCO.
Je prie MM. PÉRIGNON, DAUZATS, CARRIER, baron SCHWITER, ANDRIEU, DUTILLEUX et BURTY de s’entendre avec mon légataire universel pour classer mes dessins.
Chacun d’eux voudra bien accepter et choisir un dessin important.
J’entends expressément qu’on comprenne dans la vente un grand cadre brun représentant des Fleurs, comme posées au hasard sur un fond gris, et un Centaure à la mine de plomb.
Enfin, je lègue à MM. CARRIER, HUET, SCHWITER et CHENAVARD toutes les esquisses de Poterlet et les dessins de M. Auguste.
Je lègue à M. CHENAVARD, sus-nommé, peintre, une copie de moi du Christ au tombeau, du Titien, plus un dessin de lui d’après une Madone du Corrège.
A M. HUET, toutes mes lithographies de Charlet.
A M. PEDRON, receveur des douanes, à Mijoux, près Saint-Claude (Jura), toutes mes gravures antiques des bas reliefs de Rome, plus un grand volume rare gravé d’après Teniers (Collection de l’archiduc Léopold).
A M. PETIT, un petit tableau représentant le Centaure et Achille.
A M. TEDESCO, un tableau sur toile de 30 à 40, représentant un Grec à cheval et un Combat dans le fond.
Je m’en rapporte à MM. PETIT et TEDESCO pour les soins qu’ils mettront à la mise en vente de mes objets d’art.
Mon légataire universel choisira aussi dans mes objets d’art deux peintures et deux dessins.
Tout le surplus se vendra aux enchères.
Je lègue à M. BLONDEL, conseiller d’Etat, mon portrait non tout à fait achevé, le fond est très obscur (l’habit noir). Je regrette de ne pas être en mesure de lui donner un autre gage de mon amitié.
Ainsi que je l’ai dit, le prix de la vente de mes objets d’art servira à solder les legs en argent ; s’il y a lieu, il appartiendra pour le surplus à mon légataire universel.
Les frais d’emballage et envoi des objets légués seront à la charge de ma succession.
Dans le cas où il y aurait lieu à la réduction des legs particuliers ci-dessus faits, cette réduction aura lieu seulement proportionnellement ente les legs des sommes d’argent ; les legs d’objets mobiliers, comme le legs de ma maison de campagne, ne subiront aucune réduction.
J’ose prier M. LEGRAND, avoué près le tribunal civil de la Seine, demeurant à Paris, rue de Luxembourg, n° 45, qui m’a toujours témoigné tant de sympathie, d’aider de ses conseils mon légataire universel, et je le nomme à cet effet mon exécuteur testamentaire.
Je le prie d’accepter une réduction du tableau de Sardanapale, un grand tableau de Fleurs en hauteur, plus un beau vase du Japon, monté en cuivre doré, plus deux lampes Barbedienne, d’un assez beau modèle.
Ce testament a été ainsi dicté par M. Delacroix… l’an mil huit cent soixante-trois, le trois août, de une heure à trois heures de l’après-midi.
Le Jeudi 13 août 1863, à sept heures du matin, Eugène Delacroix s’était éteint doucement. Quelques privilégiés ont pu voir, s’enlevant sur le blanc de l’oreiller en ton olivâtre à peine jauni et sortant d’une haute cravate de mousseline empesée, ce visage à la puissante ossature, aux lèvres pincées, au front haut encadré par des mèches de cheveux noirs sans reflet. Ils n’oublieront pas la perçante attention de ces yeux bruns seulement demi-clos, ni cet air d’aristocratie exotique qui faisait penser aux princes des miniatures persanes. Ceux qui l’avaient bien connu auraient pu croire qu’il écoutait, qu’il allait répondre. Il était passé de vie à trépas, sans regrets, sans appréhensions, sans défaillance en stoïcien.
Peu de jours après, MM. Pérignon, Dauzats, Carrier, baron Schwiter, Andrieu, Dutilleux et Burty, prévenus du grand honneur que leur avait fait Delacroix au moment où il réglait les intérêts les plus chers de sa vie et de sa mémoire, se réunirent dans l’atelier et, en présence de M. Piron, le légataire universel, de M. Legrand, l’exécuteur testamentaire, et de l’expert M. Francis Petit, se livrèrent à une étude sommaire des dessins, des pastels, des aquarelles, des calques, des croquis au crayon ou à la plume, des eaux-fortes, des lithographies, qui emplissaient une trentaine de cartons de toute taille. Il y en avait au-delà de six mille ! Personne ne les avait jamais vus, sauf M. Andrieu, qui vivait depuis plusieurs années auprès du maître et l’aidait dans ses travaux. Personne, même les plus intimes amis, n’avait jamais reçu la confidence de ce labeur énorme. Aussi quelle émotion pour nous quand nous passions, des académies d’après le modèle dans l’atelier Guérin et à l’École des Beaux-Arts, si soignées, à ses carnets de voyages, couverts d’écriture chevauchant les croquis pris, en canot, sur la Tamise, au Maric, sur le pommeau de la selle, à Angerville, sur les bancs du parc, à Champrosay, dans les bois, en Belgique dans les musées ! Quelle admiration quand les projets d’ensemble, quand les études isolées pour le salon du Roi, pour les pendentifs et les culs-de-four de la bibliothèque de la Chambre des députés, pour l’hémicycle de la Chambre des Pairs, pour le plafond d’Apollon, pour la chapelle des Saints-Anges, pour les caissons du salon de la Paix, nous mettaient sous les yeux les variantes de sa pensée et de sa main, le travail incessant de sa mémoire et de sa pensée, la sûreté de son jugement, l’anxieux et noble trouble de sa science en face de la nature ! Quel charme quand les calques de ses tableaux nous faisaient feuilleter son œuvre dispersé ! Ces poursuites de costumes, d’animaux, de fleurs, de vagues, de levers et de couchers de soleil, de figures nues ou drapées dans des attitudes familières ou héroïques, d’essais d’après les antiques et les maîtres, répétées à l’infini, nous livraient le secret entier du poète et du peintre, la souple manifestation de sa science et de sa grâce.
Il avait, à plusieurs reprises dans sa vie, épuré ces cartons, brûlant ce qu’il jugeait indigne de lui survivre. Jamais il ne les avait vidés pour en tirer profit. Il voulait qu’après sa mort ses dessins vinssent, comme un argument solennel, protester contre les reproches amers d’improvisation et de facilité dont on l’avait poursuivi, et prouver qu’une « improvisation » aussi abondante et aussi solide que celle dont il avait fait preuve dans ses travaux décoratifs et ses tableaux, qu’une semblable « facilité » à exprimer par la forme et la coloration le sentiment et l’idée, à adapter l’esprit du dessin et l’éloquence de la couleur aux convenances du sujet choisi, eussent été, sans le secours préalable de l’étude la plus persistante et la plus méthodique, des phénomènes sans exemples dans l’histoire de l’art.
Au bout d’une semaine, la commission se sépara en désignant M. Burty pour la mise en ordre définitive des dessins et des carnets, et M. Andrieu pour la toilette des études peintes, esquisses, tableaux inachevés, copies d’après les maîtres, etc.
Je passai près de quatre mois dans l’atelier à chercher et à établir des classifications qui laissassent un souvenir sérieux de ce grand héritage, et qui permissent à l’expert de ne pas jeter sur table ces trésors à la brassée. Nous renvoyons au catalogue que nous avons dressé pour la vente. Si sommaire qu’il soit dans les désignations, il donne une idée claire de la succession et de l’ensemble de l’œuvre. La vente dura, avec les jours d’expositions privée et publique du mardi 16 février 1864 au lundi 29. Il y eut presque constamment vacation double dans la journée et le soir, et presque tout le même public assista sans interruption à cette dispersion d’un œuvre qui offrait quelque morceau à tous les appétits délicats. Ce fut une réhabilitation et une ivresse. On vit, on aima Delacroix. La vente, estimée à l’origine à moins de cent mille francs, en produisit plus de trois cent soixante mille. Et la spéculation, qui devait faire plus tars de l’hôtel Drouot un terrain tellement redoutable, ne s’était point encore organisée ! Tout, tableaux, esquisses ou dessins, tout fut disputé, moins par les marchands que par des amateurs passionnés ou par des artistes.
Sur ces dessins, revus soigneusement carton par carton et un à un lorsque mon travail de classement fut terminé, couraient souvent des remarques techniques, des pensées sur les arts, que Delacroix notait rapidement, sans s’interrompre dans son jet d’improvisation ou d’étude. La commission, frappée de leur originalité, de leur abondance, du complément que ces jets de génie apportaient à la figure si mal connue du maître, fut d’avis qu’il fallait les relever et les réunir en une publication, à laquelle on joindrait le dépouillement que j’avais déjà fait des albums de voyages en Angletrre, au Maroc, en Espagne, en Belgique, dans les Pyrénées, etc… [La réunion de ces pensées sur les arts, de ces notes de voyage et aussi de souvenirs inédits, paraîtra prochainement.]
En même temps, les membres de cette commission qui avaient tous été en relation suivie avec Delacroix depuis des dates plus ou moins éloignées, - je ne l’avais abordé que depuis deux ou trois ans, - me remirent les lettres de lui qu’ils avaient conservées et me promirent d’en chercher de nouvelles dans leur entourage.
C’est ainsi que naquit et que prit forme l’idée première du livre que nous publions aujourd’hui seulement.
____
Depuis, je ne cessais d’augmenter mon trésor. Je fis à plusieurs reprises des appels dans les journaux et les revues de la France et de l’étranger. Je reçus les communications les plus précieuses et j’acquis le droit d’en extraire tout ce que permet le respect dû aux morts comme aux vivants. [ J’ai acquis quelques autographes dans les ventes. Feu Gabriel et M. Etienne Charavay recevront ici le témoignage de ma reconnaissance.] Le fils de ce Soulier, qui fut l’ami le plus sûr, et dont on va voir si souvent reparaître le nom, m’envoya une copie collationnée de plus de quatre-vingts lettres transcrites par son père sur les originaux, et Mme veuve Pierret me confia sans réserve la correspondance de Delacroix avec son mari.
C’est dans ces lettres que l’on retrouvera l’expression la plus touchante de ce sentiment qui fut la caractéristique du cœur d’Eugène Delacroix : l’amitié, la constance. Aux épanchements de la jeunesse succèdent les préoccupations de la virilité, les tristesses de l’âge mûr, l’horreur de « l’injure de la vieillesse. » Son cœur ne vieillit pas, ses épanchements sont toujours aussi tendres.
Cà et là, on rencontrera les preuves de son intimité avec les hommes éminents de son temps. Et combien de dossiers ont dû disparaître ! Rien à Thiers, rien à Stendhal, rien à Mérimée ! Ses jugements piquants et toujours loyaux sur ses contemporains prouvent que l’envie seule et la sottise de certains de ses confrères purent tromper sur son génie et son caractère.
Vingt-neuf lettres, adressées au peintre Dutilleux, artiste dont les mérites se sont en quelque sorte éteints dans l’obscurité de la vie de province, m’ont fourni l’occasion de montrer Delacroix dans sa haute sollicitude pour tout ce qui touchait à la peinture. Que feu Piron, le légataire universel, Mme la baronne de Forget, la duchesse Colonna, la baronne Rivet ; que MM. le baron Larrey, Baptistin Guilhermoz, Paul de Saint-Victor, Auguste Vacquerie, Eugène Tourneux, Jehan Duseigneur fils, Arsène Houssaye, Pierre Andrieu, E. Moreau, Charles Blanc, Pierre Petroz, Pingard, Benjamin Fillon, Villot fils, Gigoux, Lassalle-Bordes, J. J. Arnoux, le docteur Auguier, Michaux, Marquiset, Cottenet…, reçoivent nos remerciements pour leur concours à une publication dans laquelle mon rôle était de me dissimuler, de coudre seulement par de courtes notes une suite ininterrompue de documents personnels, qui va de 1804 à 1863, de la maison paternelle au tombeau.
Par-dessus tout, le concours de Léon Riesener, qui quitta brusquement la vie presque au moment où j’achevais ces lignes, m’a été utile. Nous avons souvent agité ensemble le projet d’une notice biographique, que pour ma part je jugeais inutile, étant peu porté, par mes habitudes de critiques, à me substituer à ceux qui peuvent prendre eux-mêmes la parole, et la série de ces lettres composant une réelle autobiographie, sincère et animée. Aujourd’hui, le bon et spirituel Léon Riesener n’est plus là pour m’encourager et me rectifier ; j’ai jeté mon manuscrit au feu. Je crois ne pouvoir faire mieux que de transcrire ces curieuses notes que, dans sa modestie, le parent et l’ami d’Eugène Delacroix ne m’avait remises que comme matériaux.
Depuis la publication de la première édition, M. Lassalle-Bordes a rendu le même service à la mémoire du Maître. Les notes qui ouvriront le second volume, prises pendant la période des grands travaux décoratifs, aident à compléter définitivement la physionomie d’Eugène Delacroix.
___
Voici les notes de Léon Riesener.
« … Je vais tâcher de rassembler mes souvenirs… Dans les relations où a puisé Véron (un manuscrit autobiographique que lui avait prêté Delacroix et dont il fut publié une partie dans les Mémoires d’un bourgeois de Paris) vous trouverez les incidents de sa jeunesse, les dangers qu’il a courus d’être brulé, d’être noyé dans le port de Marseille en tombant des bras d’un fidèle serviteur entre deux vaisseaux de guerre (son père, alors préfet, visitait en cérémonie un de ces vaisseaux) ; son enfance, chez sa mère, avec Mlle Cervoni, fille du général italien Cervoni, les leçons de musique, sa vocation pour cet art, ses premières impressions de peintre, à propos des Martyrs du Corrège, qui nous ont été enlevés en 1815, vous sont connu. Déjà sa tendance était tracée, car je connais, dans ses cartons, des compositions représentant la Saint-Barthélemi et des sujets analogues où les assassins tâtent du doigt la finesse de leur pointe avec les expressions terribles et profondes qui sont le tempérament de sa peinture. Un sculpteur italien qui modelait le médaillon de son père lui fit une grande impression. Il ne rencontrait plus un plâtre sans se demander :
Sera-t-il dieu, table ou cuvette ?
Puis l’atelier de mon père, son oncle, qu’il vit plusieurs fois peignant. Ce fut mon père qui lui conseilla l’atelier de M. Guérin. Delacroix venait de perdre sa mère. Il avait perdu son père avant, et toute la fortune de ses parents dans un procès où il s’agissait de forets en Champagne. Il ne resta en tout à l’orphelin, de la fortune de ses parents, qui avaient occupé une si haute position, que deux couverts d’argent et un pot à l’eau en porcelaine dorée. Sa mère habitait au premier étage de l’une des maisons qui font face au bureau de poste du Palais-Bourbon, rue de Bourgogne. Delacroix quitta l’appartement maternel pour mener la vie d’étudiant. Sa mère, qui l’aimait beaucoup, était fort aimable et du grand monde d’alors. Delacroix avait pris auprès d’elle des relations et des façons de monde qu’il ne cessa de cultiver. Il me disait que le jour des obsèques de sa mère, regardant machinalement au travers de la vitre les apprêts funéraires, il se reprochait de ne pas trouver dans son cœur de sanglots à la hauteur d’un tel malheur. Il se trouvait froid, concentré, et exprimant médiocrement son chagrin, quand il vit s’arrêter sous les fenêtres une pauvre femme habituée à y recevoir régulièrement quelque aumône :
« Ah ! dit-il à la pauvresse »en lui-même,« elle n’est plus, celle qui te donnait, pauvre femme ! »Les sanglots le suffoquaient, il pleura et se désespéra jusqu’à inquiéter sa sœur et ceux qui étaient présents.» Les relations de Delacroix lui conservèrent dans le monde les manières délicates qu’il avait prises chez sa mère. Arrivant à l’atelier bien élevé, il se lia avec Scheffer, Champmartin, les principaux élèves de M. Guérin. Le talent ne se développe pas inopinément. Delacroix m’a parlé de l’influence qu’un certain Champion avait eue sur le talent de Géricault lui-même et sur tous les élèves de l’atelier Guérin.
» C’est au retour en France de mon père [le père de Riesener était allé peindre des miniatures en Russie] que je connus Delacroix. J’eux pour lui de suite une amitié de jeune frère. Delacroix aimait beaucoup ma mère, qui, jeune veuve, se retira à la campagne, dans la vallée de Montmorency. Nous allions souvent la voir ensemble, même l’hiver. Je me rappelle des promenades dans les bois couverts de neige, bien égayés par un rayon de soleil et par l’aimable esprit de mon ami.
» Après le Massacre de Scio, M. de La Rochefoucauld fit appeler Delacroix. Ce n’était pas pour lui commander des travaux, mais pour lui recommander
« de dessiner d’après la bosse. »Depuis, Delacroix rencontra souvent, chez des amis communs, M. de La Rochefoucauld, redevenu homme de sens depuis qu’il n’était plus directeur des Beaux-Arts. Ils rirent souvent de la scène d’alors et de la recommandation.» Le roi Louis-Philippe, alors duc d’Orléans, commanda des tableaux à Delacroix, entre autres le Cardinal de Richelieu disant la messe, qui périt en 1848, mais il n’aimait pas sa peinture. M. de Cailleux, au nom du roi, offrit deux mille francs des Femmes d’Alger, pendant qu’au même salon on payait trois ou quatre mille francs à Decaisne un tableau insignifiant, de mêmes dimensions, l’Ange gardien. Delacroix ne voulait pas subir cette maladroite comparaison. Le roi insista, promettant de
« revaloir la différence sur un autre travail. »« Pour les Croisés à Constantinople, Delacroix avait proposé une esquisse fort belle. M. de Cailleux lui fit entendre que le roi désirait autant que possible un tableau
« qui n’eut pas l’air d’être un Delacroix. »C’est au respect humain et non à l’estime que nous devons ce que nous avons de lui dans les galeries de Versailles.» Delacroix vécut quelque temps avec Fielding. Pour faire du café le matin, on ajoutait de l’eau et un peu de café sur le marc de la veille, dans l’unique bouilloire, jusqu’à ce qu’on fût forcé de la vider. De temps en temps, on avait un gigot en provision dans l’armoire, auquel on coupait des tranches pour les rôtir dans la cheminée. Mais un jour, les deux amis partageant ce déjeuner se fâchèrent. Fielding disait très sérieusement qu’il descendait du roi Bruce ; Delacroix l’appelait « sire. » Mais Fielding ne pouvait, sur ce sujet, admettre la plaisanterie, et se fâcha pour toujours.
» Delacroix me racontait comment, dans sa jeunesse, amoureux d’une petite Anglaise, femme de chambre de sa mère (il a conservé d’elle un petit portrait charmant, un chef d’œuvre), il s’était glissé à tout hasard, la nuit, dans un corridor. Dans l’anxiété et la maladresse d’une pareille échappée, il accrocha une immense échelle que des maçons appelés pour réparation avaient laissée debout contre le mur. Voilà l’échelle qui grince peu à peu, et s’abat enfin avec un grand fracas, et, pour l’éviter, le jeune aventureux se jette dans un tas de plâtre. – Sa jeunesse ne fut pas toujours aussi malencontreuse.
» Il conserva la vie simple, et aimait les retours aux façons de sa jeunesse. Les diners à la barrière, à la campagne, le petit vin lui plaisaient ; et cependant il aimait le bon, mais en petit comité de trois ou quatre amîrs, et l’on y parlait peinture, drôleries, philosophie. Pendant longtemps, lui, Henri Hugues, fils d’une sœur de sa mère, et moi, nous nous réunissions une fois par semaine, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, à tour de rôle, ou chez le restaurateur. Il apportait dans ces diners une gaité aimable, toujours conciliante, et une amitié attentive, affectueuse pour le cousin Henri, notre ainé, homme charmant, ingénu, chevaleresque, que Delacroix aimait de tout son cœur, et dont la souvenir lui est resté cher constamment. Il en a fait un beau portrait qu’il me donna. Henri, employé dans l’administration des Postes, poète par délassement, était plus que négligé dans sa toilette. Je me rappelle qu’une fois, à grand’peine, nous sortions d’une représentation extraordinaire de l’Auberge des Adrets, donnée, je ne sais pourquoi, le jour, par Frederick-Lemaître. Le chapeau et la tenue de Henri sortant du théâtre étaient réellement plus que comiques. Delacroix, très élégant et recherché dans sa toilette, lui donna impassiblement le bras en plein boulevard, et, gai comme un pinson, jouissait de l’esprit de son vieil ami : c’est à l’amitié de ces deux hommes que je dois ce que j’ai de bon, à mes yeux.
» A Valmont, en Normandie, nous avons passé quelques vacances. Tantôt il était tout feu pour le travail, et faisait des aquarelles délicieuses qui ont été vues à sa vente ; tantôt ne pouvant d’y mettre, il se mettait à mouler avec passion des figurines qui ornent les tombeaux des moines d’Estouville, fondateurs de l’abbaye de Valmont. Nous travaillions à ces moulages quelquefois après diner, à la lanterne, malgré les observations di domestique du propriétaire absent, car l’église servait de bûcher. C’était dans l’arrière. L’eau gelait. Le toit de l’église était à jour. Les rayons de la lune y pénétraient et étincelaient dans les feuillages couverts de rosée qui poussaient dans la nef. Nous nous donnions, l’un après l’autre, le spectacle des ombres immenses que nous projetions avec art sous les colonnades des bas-côtés. Delacroix a toujours eu cette particularité d’être jeune par l’imagination. Il a eu l’ennui des chagrins, l’ennui des mécomptes, mais la jeunesse de son esprit a toujours effacé ces maux au moindre répit. Disposé à ne pas attendre grand bien de l’humanité, à compter peu sur le cœur humain, il aimait ses amis tels quels, parce qu’il les aimait de sympathie. Il était d’une indulgence extrême pour leurs défauts. Il rapprochait de lui, par un intérêt véritable et une franche cordialité, les ouvriers, les domestiques qu’il trouvait intelligents et dévoués, et se plaçait dans ce cas, vis-à-vis de ses inferieurs, dans une véritable égalité. Vizentini fut un de ses modèles et serviteurs d’affection. Il fut le même pour ses marchands de tableaux, son maçon, son serrurier, qu’il estimait très haut. Ce qui le charmait, c’était l’intelligence naturelle et la vraie bonté. L’esprit ne lui suffisait pas.
» Il était très fin, soupçonneux et détestait les manèges, qu’il exagérait peut-être dans ses soupçons. Il aimait la louange et ne se plaignait pas qu’elle prît une forme exagérée. Mais il connaissait le prix de la sincérité. L’hiver dernier [quelques unes de ces notes avaient été prises en 1863, peu après la mort du maître.], il me témoignait son embarras à propos d’un petit tableau qu’il ne savait comment finir et qui ne lui plaisait pas. Je lui donnai de ces avis toujours faciles à celui qui arrive avec la clairvoyance du premier aspect. Il les trouva bons. Une semaine après, dès qu’il me vit entrer, il me montra son tableau tout changé et m’en remercia. Je repoussai ses remerciements, disant que tout le monde lui en eût dit autant.
« Non, me dit il, ce n’est pas ainsi que tu le penses. Il faut qu’un véritable ami se trouve là, à propos, qu’il soit éclairé et qu’il vous dise ce qu’il voit. Tu me l’as dit, et je t’en remercie comme d’un grand service. »Que de bonne et sainte camaraderie dans un aussi grand talent !...» Son art a été le but de sa vie. Il lui a tout sacrifié et même en dernier lieu sa vie elle-même. Pour avoir la tête plus lucide, pour être plus propre au travail, il avait fini par supprimer le déjeuner et ne mangeait qu’une fois par jour. Les médecins l’ont prévenu qu’il se tuerait. Il prétendait sentir mieux qu’eux ce qui lui convenait ; s’il déjeunait, il ne pouvait travailler, et il ne pouvait se résoudre à cesser le travail.
» Jouffroy, dans son Discours à l’Académie, lui fait un trop gros mérite d’avoir rendu justice à M. Ingres. Quand j’étais élève, ce fut lui qui me montra le mérite des talents de M. Ingres. Les académiciens d’alors s’en moquaient. Ses principes sur l’Art étaient généreux et grands, et mêlés d’une foule d’observations tirées de la nature. Il l’étudiait continuellement, en omnibus, au spectacle, partout, au point de vue des lois naturelles, de l’effet et de la construction humaine. Il cherchait dans la nature des principes généraux plutôt que des personnalités intéressantes. Il avait du sentiment, la grâce des lignes et le lien des figures, la vérité expressive du geste et toutes les qualités supérieures de la composition, qu’il approfondit par l’étude. Ses lithographies, d’après des médailles antiques et étrusques, font foi de son intelligence profonde de cet art.
» Il était convaincu que les tableaux du Titien et de Rembrandt avaient été faits clairs et naturels, et que l’art moderne était malade de l’imitation des vieux tableaux.
« Si Titien et Rembrandt pouvaient voir ce qu’on admire d’eux, disait-il, ils seraient bien étonnés et se croiraient dans un monde d’imbéciles. Quoi ! demanderaient-ils, vous croyez que j’ai fait cela ? »Dans le premier moment, il fut contre les restaurations de Villot. A la fin, il avait changé d’avis,« et même pour la Kermesse, »me dit-il un jour.» Voilà, cher monsieur, ce que j’ai pu me rappeler jusqu’à l’époque où vous connaissez Delacroix aussi bien que moi. Quant aux amphigouris, aux répétitions et aux obscurités de mes phrases, excusez-les. Je ne peux pas penser à la fois, me rappeler et bien dire. Il m’aurait fallu corriger et je ne suis pas à cela près avec votre amitié que je veuille lui cacher mes faiblesses… »
L. R.
Nous ne voulions pas arrêter plus longtemps le lecteur sur le seuil de cette publication. Qu’il entre. Delacroix va parler. Ce sera partout sur le ton d’un lettré, d’un homme de bonne compagnie ; souvent sur le ton d’un fin critique et plus souvent encore d’un philosophe du siècle dernier. Ses premières confidences sont d’une juvénilité charmante.
Mais ce recueil de lettres, - quelques soins que nous ayons apportés à le faire aussi complet que possible, et malgré les documents nouveaux qui nous sont arrivés, - renferme plus d’une lacune. Si quelqu’un des amis du maitre, si quelque collectionneur d’autographes n’ont point eu connaissance de nos appels, nous espérons qu’une fois avertis par ce volume, ils voudront bien nous faire part de leurs richesses. L’accueil fait à la première édition a prouvé combien l’Etranger et la France ont pris de respect pour l’Ecole romantique et quelle part est faite à Eugène Delacroix dans cette réhabilitation.
Une pareille constatation était faite pour nous payer, et au delà, de tous nos soins".